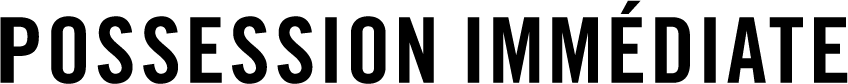The Wainting room, nouvel album des Tindersticks
john jefferson selve
Mathieu Terence / le Talisman
Ce qu’il y a de remarquable dans l’œuvre de Mathieu Terence se rattache à sa tenue. Cette œuvre se tient à la fois droite et protéiforme dans le but qu’elle poursuit. Aucune reddition littéraire. Elle ne dévie pas. De livre en livre, l’auteur trame les fils d’une quête où se mêlent essais, matériaux autobiographiques, philosophie et saisie d’un temps, de notre époque dans une démultiplication des points de fuite pour tenter d’en extraire une vérité. L’auteur est en quête. Son sujet est l’existence. Et son approche, même quand elle se situe dans la veine autobiographique, comme son dernier roman Le Talisman, déborde toujours et de loin l’egotrip ou les petites histoires sentimentales dont nous gave aujourd’hui la production littéraire française.
Le Talisman commence sur la mort de Farrah, jeune femme flamboyante, faussement sauvage, irritante et fascinante parce que vivante. Se souvenir d’elle est pour l’auteur la possibilité de déterrer un fil autobiographique, d’évoquer une succession de portraits féminins et de constater que le plein de vie, souvent, dérange ou ennuie. Et ce geste provoque tout au long du livre des gerbes de terres qui, loin d’enterrer Farrah, disséminent et poudroient une écume pleine des réminiscences d’une vie où se trouver devient difficile. Des femmes aimées aux anorexiques côtoyées pendant son travail, Mathieu Terence fixe une féminité indomptée ou malmenée. Mais chez lui les faits ne s’installent jamais au firmament d’une poésie ou d’un chant dépassé à la gloire de la disparue, aucun Memento mori ; ceux-ci s’inscrivent, décrivent et écrivent notre société. Cette disposition de Mathieu Terence est précieuse parce qu’elle se situe entre la plus solide pensée et la plus grande sensation. Ce faisant, il n’obéit pas au monde et à ses sentences, mais le questionne en permanence.
« Il ne s’agit pas d’échapper à la mélancolie, il s’agit de ne pas lui céder », écrit l’auteur. Dès lors, il convie ses obsessions intellectuelles, sa capacité à fixer jusqu’aux détails et leurs écarts l’amorce d’une sensation pour établir un traité de présence au monde. Ainsi, son geste oscille entre l’esquisse d’une déhiscence féminine qui lui sert de révélateur – et peut-être de miroir – et la parfaite analyse des petits soubresauts sociaux qui n’aiment rien d’autre qu’à crucifier la différence.
« La tâche de l’artiste, mais de tout homme, est celle d’empêcher que le miracle ne meurt… ». C’est aussi pourquoi Mathieu Terence convoque dans son livre en quête son propre code. Ce qui le maintient vivant et droit. À la manière d’un samouraï, il revient sur ses amours intellectuelles. Elles permettent le triumvirat qui fait le socle de son livre. L’équilibre advient entre l’obsession féminine, l’esquisse d’une société toujours plus médiocre et la recherche d’un esprit du temps. Et ces trois voix sont un tout. Un talisman, un mouvement musical porté par l’écriture de la mort de Farrah pour dire notre souffle.
John Jefferson Selve
HORIZON
Bruno Perramant
Animal Contraction
texte paru dans Purple Fashion magazine n°24 (fall winter 2015 / 2016)
Je réalise aujourd’hui que ma fascination pour les drones s’était substituée – sans que je ne le réalisasse avant – à ma fascination pour les animaux et les documentaires animaliers regardés tout au long de ma vie en état de quasi hypnose. Je le réalise en lisant Le Versant animal de Jean-Christophe Bailly et en observant cette image de presse tristement célèbre de l’un des derniers rhinocéros blanc du Zimbabwe. L’animal, dans une sorte de soubresaut de conscience de la part des hommes, est dorénavant protégé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par quatre militaires afin qu’on ne vienne pas le tuer pour voler sa corne. À l’instant où je réalise cela, tout s’entremêle : prédation, proies, guerres, anéantissements, altérité, enfance, ouverture et pure présence. Parce que l’animal est tout ça et bien plus.
Ce qui est en jeu est l’immédiateté du vivant à lui-même. Ce qui est en jeu est aussi un rapport au monde et à sa sensation que l’on nous escamote. Parce que ce rapport à la sensation animale n’a aucune valeur d’usage et d’échange, encore moins de valeur ustensilaire. L’animal nous conduit dans un « hors-notre-monde » tel que nous l’avons bâti et pensé.
L’homme est aujourd’hui pauvre en monde comme Heidegger avait tenté de dire que « l’animal était pauvre en monde ». L’être humain (occidentalisé) n’est plus capable d’écouter ni de voir. La tragédie se joue ici comme un impensé et même si toute une littérature alerte de la situation, elle n’est qu’un dérisoire sémaphore quant à l’état d’urgence présent.
Au moment même ou penseurs et scientifiques tirent en vain la sonnette d’alarme pour nous prévenir, chiffres à l’appui, de la disparition massive des espèces animales, nos yeux restent indifférents. Il est urgent de nous ressaisir de notre pensée mais aussi de la pensivité de l’animal et d’unir dans une sorte de sensation commune nos respirations.
Nous devrions comprendre que le monde est traversé par toutes les intelligences : ne se soucier que de la nôtre, c’est vivre en regardant par le bout de la lorgnette. C’est appauvrir les choses. C’est comprendre aussi pourquoi l’homme dévaste les mers, la terre, le langage. Il y a une poétique de l’habitation animale sur la terre. L’observer c’est déjà pister des traces de pensée.
Merleau-Ponty pense chaque animal comme une contraction précise de l’espace-temps. Je pense à la phrase de Bataille : « L’acte sexuel est dans le temps ce que le tigre est dans l’espace. »
Il n’y a pas d’exclusivité humaine du sens, nous dit Bailly : l’animal et son apparence sont à comprendre entièrement comme un langage, il n’y pas d’exclusivité humaine de l’intelligence.
Nous le savons, les animaux ont des émotions. Qu’il s’agisse de l’animal sauvage ou de compagnie : de sa joie, de ce rire dont il est capable, de l’éléphante pleurant son petit abattu par le braconnier, ou de la vache apeurée que l’on mène à l’abattoir, ces émotions sont peut-être infra ou extra humaine mais le problème n’est pas là : elles existent. Nous refoulons ou nions ces phénomènes par confort. Ils nous obligeraient à révolutionner notre pensée de fond en comble et de cela nous n’en avons pas envie. Il n’y a guère que les enfants capables aujourd’hui de se réjouir du prodige animal et de son existence.
La puissance de manifestation de l’existence animale, nous la côtoyons chaque jour. La ressentir ou la reconnaître est essentiel. Le raffinement de la pensée – son avalanche et son abandon que peut provoquer le surgissement animal – doit traverser cette sensation.
Face à la bête, la pensée glisse toute seule devant ce qu’elle voit, qui est alors ce qu’elle a cessé de rapporter à une conduite ou à une fin, nous dit Jean-Christophe Bailly.
Les mots « biodiversité » et « environnement » sont inadéquats car ils nient dans leur empaquetage la somme des singularités vivantes. Ces mots prolongent l’idéologie prétentieuse de l’homme à se mettre au sommet de la création. Tout cela ne veut plus rien dire.
Contre cette hiérarchie, il y a là une a-narchie à penser. Pour éviter la dévastation, il est grand temps de prendre en compte le destin animal.
Bailly toujours : « L’animal évadé de sa condition d’objet de la pensée, devient lui-même pensée, non en tant qu’il pense ou penserait (finalement on s’en fout !) Mais parce qu’il est. »
Au lieu de ça, nous célébrons les animaux en les modifiant génétiquement comme s’ils n’étaient que pure matière ou bien par une appropriation mimétique de la geste animale en faveur de la technique : il est troublant de voir pulluler ces projets de drones guerriers terrestres ressemblant à des chiens, des serpents ou des insectes. Au moment même où certains d’entre nous constatent la disparition massive des animaux, l’homme se constitue un bestiaire guerrier et potentiellement létal. Se détruire par des ersatz d’animaux : si il y a là une allégorie, elle ne peut être, au sens propre, que maléfique et cynique.
Nous avons réduit l’animal à une contraction, qu’elle soit technique, scientifique, guerrière ou alimentaire, nous ne l’envisageons plus que sous le prisme de la réduction ; niant sa puissance de déploiement, son surgissement, son altérité et sa poétique d’existence.
L’anthropocentrisme rayonnant, technique et post industriel se moque bien entendu de ces impressions-là. Elles ne rapportent rien.
John Jefferson Selve